
13 Nov 2025
Posté le dans Décryptage, Non classé

À l’occasion de la Semaine du Handicap 2025, la question de l’emploi des personnes en situation de handicap s’impose avec force. Depuis quarante ans, l’obligation d’emploi constitue un socle essentiel pour favoriser leur accès au marché du travail. Pourtant, malgré ce cadre légal, les inégalités persistent et montrent que le respect de l’obligation ne suffit plus : l’enjeu consiste désormais à bâtir une inclusion réelle, durable et équitable au sein des entreprises.
Quarante ans de politiques inclusives : une avancée à nuancer
Depuis l’instauration de l’OETH, le taux de chômage des bénéficiaires a reculé, signe que l’embauche progresse lentement mais sûrement. Cependant, l’intégration ne s’arrête pas à l’accès à l’emploi. Elle implique des conditions de travail équitables, des évolutions de carrière réelles et l’absence de discrimination.
Pourtant, malgré un cadre législatif dense, les écarts persistent, révélant un décalage entre les ambitions affichées et la réalité du terrain.
Obligation et accords agréés : une expérimentation aux résultats mitigés
Les accords agréés, qui prendront fin en 2026, ont montré une efficacité mesurable, avec une hausse de 0,5 % de l’emploi des BOETH au sein des entreprises signataires. Toutefois, dès 2014, des doutes ont émergé quant à la cohérence entre budgets mobilisés et actions réellement menées.
Leur disparition retire un outil de gestion aux organisations, mais elle met en lumière un point essentiel : l’inclusion ne peut exister sans un dialogue social actif et exigeant. Une question reste alors entière : comment les employeurs dépasseront-ils le strict cadre légal pour améliorer durablement les pratiques ?
Dialogue social : un rôle essentiel pour les CSE et les syndicats

L’inclusion doit être construite collectivement. Employeurs, représentants syndicaux et CSE partagent ici une responsabilité centrale. Pour négocier efficacement, ils doivent accéder à des données précises sur les freins, les inégalités et les marges de progrès.
Or, la BDESE et les bilans sociaux se limitent trop souvent à vérifier le respect de l’OETH, sans examiner les disparités qui persistent. Cette vision partielle limite la capacité d’action des élus et affaiblit les politiques d’inclusion.
L’obligation face aux enjeux de l’analyse intersectionnelle
Pour mieux identifier les discriminations, il est indispensable de croiser les critères : genre, âge, ancienneté, catégorie socio-professionnelle… Car le handicap ne se vit jamais seul.
Les études récentes confirment cette réalité. Le Sénat rappelle que 60 % des TMS concernent des femmes, tandis que les travaux de Mathéa Boudinet mettent en évidence une double discrimination pesant sur les femmes handicapées. Ces données montrent combien une approche intersectionnelle permet de dépasser la seule logique de l’obligation.
Obligation, expertise et négociation : des leviers pour transformer les pratiques
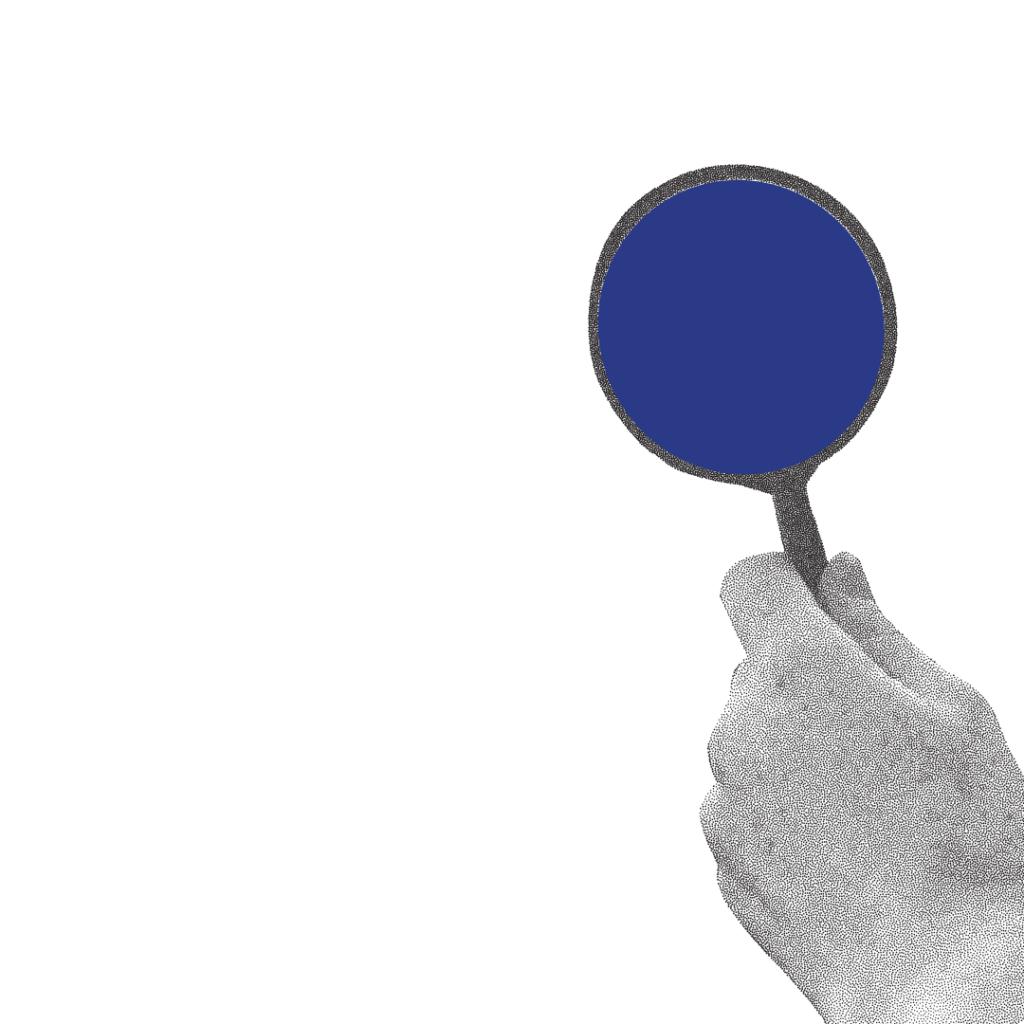
Une analyse fine menée lors des consultations sociales permet de rendre visibles des inégalités souvent ignorées. Parallèlement, une expertise économique et financière met au jour l’usage réel des budgets, offrant ainsi un appui solide aux équipes de négociation.
Pour les représentants du personnel, l’enjeu est clair : suivre ces indicateurs, documenter les écarts et transformer ces constats en actions concrètes pour faire bouger durablement les lignes.
Au-delà de l’obligation, un impératif collectif
L’inclusion n’est pas seulement une exigence légale ; elle constitue un enjeu de justice sociale et un levier de performance pour l’entreprise.
Les syndicats, les CSE et l’ensemble des acteurs du dialogue social peuvent s’appuyer sur leurs réseaux et sur des organisations comme l’Agefiph pour renforcer leurs propositions. Car, derrière les textes et les chiffres, une conviction demeure : offrir à chacun une place juste et légitime dans l’entreprise.


