
08 Sep 2025
Posté le dans CSE en actu, Décryptage, Politique sociale

Depuis la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé comme un acquis pour des millions de salariés en France. Pourtant, de nombreuses entreprises reviennent aujourd’hui sur ces pratiques. Certaines imposent un retour obligatoire au bureau, parfois à temps plein. Officiellement, l’objectif est de renforcer la cohésion et la créativité des équipes. Officieusement, ces politiques peuvent aussi pousser certains salariés à partir « volontairement ».
Ce phénomène, qualifié de PSE déguisé, reste difficile à chiffrer. Mais il suscite des tensions croissantes entre directions, salariés et élus CSE. Entre enjeux juridiques, impacts sociaux et données encore parcellaires, un constat s’impose : le retour au bureau n’est pas qu’une question d’organisation, c’est un véritable sujet de dialogue social.
Pas de chiffres officiels… mais une réalité sociale bien présente
À ce jour, aucun chiffre officiel ne permet de relier directement l’annulation du télétravail à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). La raison est simple : ces départs ne sont pas déclarés comme tels. Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise après l’imposition d’un retour au bureau, cela prend souvent la forme d’une démission ou d’une rupture conventionnelle. Ces mouvements échappent aux statistiques nationales.
Dans de rares cas, le refus de revenir en présentiel peut mener à un licenciement pour faute. Mais il s’agit d’exceptions. Pourtant, les analyses juridiques et sociales convergent : le retour imposé au bureau crée un climat de tension et peut, de manière indirecte, conduire à des réductions d’effectifs massives.
Le « PSE déguisé » : quand le retour au bureau provoque des départs cachés
Un PSE classique est une procédure lourde et coûteuse. Elle impose aux entreprises de négocier des mesures de reclassement et d’accompagnement. Face à cette complexité, certaines directions choisissent une voie plus subtile. En supprimant le télétravail, elles créent des conditions de travail jugées inacceptables par certains salariés.
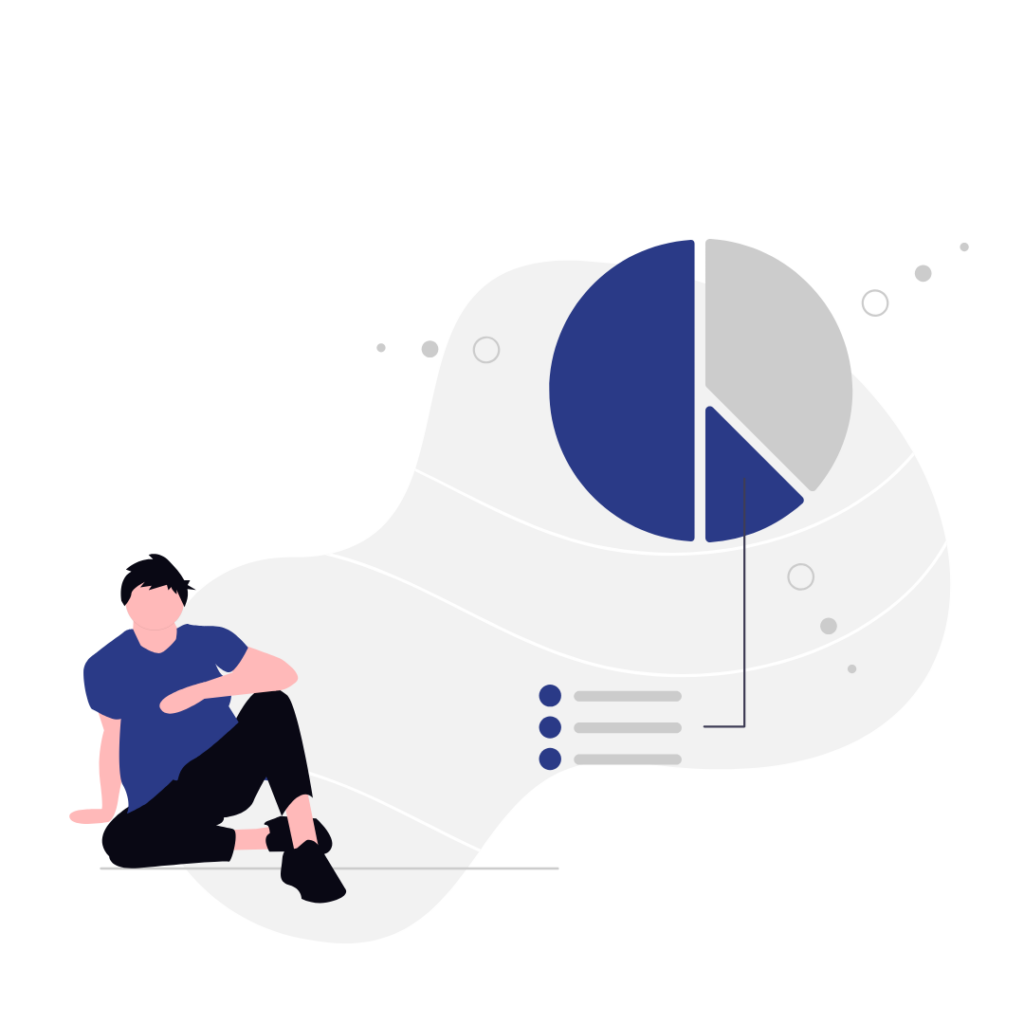
Résultat : beaucoup préfèrent partir d’eux-mêmes. La rupture conventionnelle devient alors l’outil privilégié pour solder la relation de travail à l’amiable. D’autres salariés, découragés, choisissent tout simplement de démissionner. Selon une étude de l’APEC (mars 2024), 45 % des cadres seraient prêts à quitter leur poste si l’accès au télétravail leur était retiré. Ces départs, bien qu’étroitement liés à la politique de retour au bureau, ne sont pas comptabilisés comme des licenciements économiques. C’est pourquoi certains experts parlent de « PSE déguisé ».
Télétravail et loi : jusqu’où un employeur peut-il imposer le retour au bureau ?
La possibilité pour un employeur de mettre fin au télétravail dépend du cadre dans lequel il a été mis en place. Lorsqu’il repose sur un accord collectif ou une charte d’entreprise, les conditions de retour en présentiel doivent respecter les clauses prévues. Si le télétravail est simplement issu d’un accord individuel, écrit ou même oral, la situation est plus complexe.
Dans certains cas, le télétravail régulier peut être considéré comme un élément essentiel du contrat de travail. L’employeur ne peut alors pas y mettre fin unilatéralement. Un refus du salarié de revenir au bureau ne constitue pas un motif de licenciement pour faute grave. L’entreprise peut être contrainte de proposer une modification du contrat pour motif économique. Si plusieurs salariés sont concernés, cela peut déclencher, paradoxalement, un véritable PSE.
Retour obligatoire au bureau : ce que disent les chiffres en France
Le phénomène du retour en présentiel est tout de même rare. Selon Hellowork, 7 entreprises sur 10 imposent simplement un nombre minimum de jours de présence au bureau . Une enquête menée par Slack/OpinionWay confirme ce chiffre, tout en révélant que 62 % des salariés aimeraient télétravailler au moins la moitié du temps (source : IT Social).
L’Insee observe que, sur le deuxième trimestre 2024, 22,4 % des salariés du privé ont télétravaillé au moins une fois par mois, avec une moyenne de 1,9 jour par semaine. La même année, seuls 4 % des salariés étaient en « full remote ».
Enfin, une étude internationale d’Unispace (septembre 2024) montre que 94 % des employeurs et 87 % des salariés jugent satisfaisant un modèle hybride basé sur trois jours au bureau par semaine.
Stress, démissions, productivité : les vraies conséquences du retour au bureau
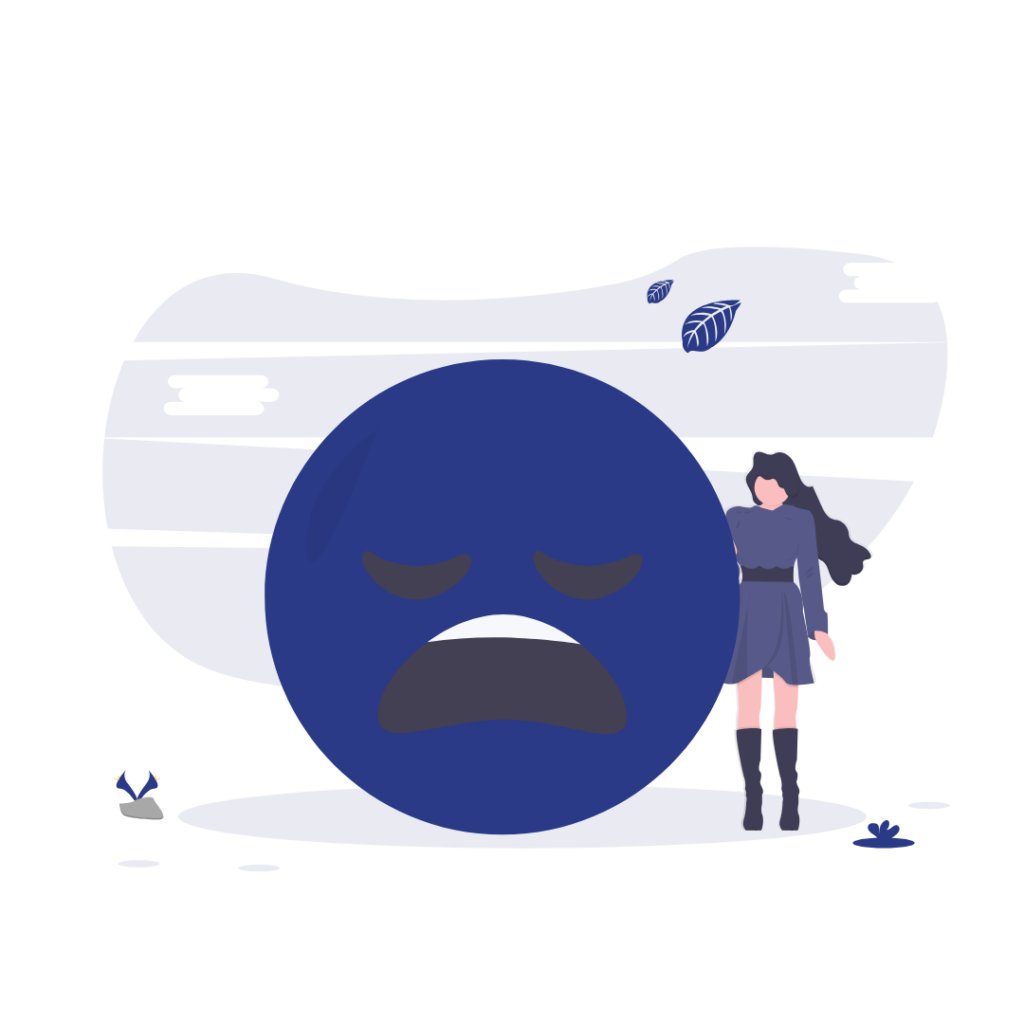
Imposer un retour au bureau n’est pas sans conséquence. La fin du télétravail, ou sa réduction drastique, entraîne aussi une hausse du stress et de l’anxiété. Ces effets sont particulièrement marqués chez les employés non-cadres, souvent les premiers touchés par des politiques de retour à temps plein.
Du côté des employeurs, l’argument avancé est souvent le même : renforcer la cohésion, la créativité et l’esprit d’équipe. Pourtant, de nombreuses recherches démontrent que la productivité reste stable, voire supérieure, en télétravail pour certains métiers. Le débat reste donc ouvert : la présence au bureau est-elle un réel gage de performance ou un outil de contrôle social ?
CSE et syndicats : comment agir face aux PSE déguisés liés au télétravail ?
Les élus CSE et les organisations syndicales jouent un rôle essentiel dans ce contexte. Leur mission première est de recueillir la parole des salariés. Les témoignages permettent de mettre en lumière les situations où la suppression du télétravail équivaut, dans les faits, à un PSE déguisé.
Ils doivent également analyser les accords collectifs et les chartes internes pour identifier les clauses de réversibilité du télétravail. En s’appuyant sur les données disponibles (taux de départs, niveau de satisfaction, productivité) ils peuvent étayer leurs revendications. Enfin, la négociation d’un modèle hybride reste une piste de compromis réaliste. Dans tous les cas, le recours à des experts indépendants est précieux pour décrypter les mécanismes et accompagner le dialogue social.


